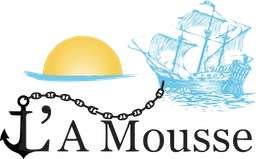« Ma mère préférait nourrir notre esprit et notre avenir que notre ventre » HISTOIRE DE LA REUNION

Dans le précédent article, notre célèbre et grand Réunionnais, Clovis Etchiandas a raconté la vie de son père. Dans le récit qui suit le guide narre la vie la vide sa mère. Le Saint-Leusien rend un hommage appuyé, rempli d’émotions et d’amour, tout en retenue, à celle qui demeurera à jamais, la plus belle femme du monde qui un jour, est devenu un ange. Une étoile au firmament. Une autre façon que Clovis Etchiandas de dire : « Je t’aime, maman ! »
« Ma mère Marie Thérèse Hérode est née le 30 mars 1935 au Cap Saint-Leu. Elle était la dernière d’une fratrie de douze sœurs et frères. Et comme dans les traditions familiales de l’époque, elle vivait avec sa mère, même après son mariage. Ma mère était une femme discrète, tellement discrète que j’ai longtemps cru que ma grand-mère, était ma mère. Difficile de s’affirmer quand on a comme maman, une mère à forte personnalité ».
Aussi, pour une bonne partie de sa vie, ma mère a vécu dans l’ombre de grand-mère, sans la contrarier. Ma voisine, d’un âge avancé, me racontait que dans les premières années de mariage de ma mère, ma grand-mère ne se gênait pas pour lui envoyer une « taloche » si elle lui manquait de respect.
Dans sa prime jeunesse, ma mère était une belle fille métissée qui attirait les regards, mais surtout la jalousie des autres filles de son quartier. Sa démarche hautaine n’était pas faite pour arranger les choses. Il fallait la voir le dimanche quand elle « cassait l’armoire » pour se rendre à la messe avec grand-mère.
Pour la petite histoire, toutes les deux descendaient le chemin canal, les chaussures à la main, jusqu’à la route à la boutique « Lingou » et de là, elles se lavaient les pieds et se rechaussaient pour se rendre à l’église.
De son enfance jusqu’au début de son adolescence, ma mère comme l’exigeait grand-mère, était allée à l’école des sœurs Sainte-Thérèse en ville de Saint-Leu. C’était plutôt un privilège pour l’époque, réservé aux enfants des familles des notables de la ville. Mais, grâce à la perspicacité de grand-mère qui livrait le lait au gratin de la bonne société de Saint-Leu, ma mère et plus tard, mes deux sœurs ont pu se rendre à cette réputée école religieuse.
Ma mère était une fille comme elle le disait elle-même, qui avait « bonne tête » pour apprendre, mais malheureusement, elle ne gardait pas un souvenir impérissable de son passage à Sainte-Thérèse. Etant fille de « colon » désargenté, elle subissait souvent les brimades des sœurs institutrices qui régulièrement la faisaient s’agenouiller pour la punir sur des grains de « filaos ». Elle était leur souffre-douleur bien qu’elle n’était pas la plus « couillonne » des élèves de sa classe.
Par manque de chance, à l’heure du passage de l’examen du certificat d’études, elle est tombée malade, on ne lui avait pas donné une deuxième chance pour le passer. C’est un peu l’histoire de sa vie. Ceux qui l’avaient réussi, ont intégré la bonne société bien pensante de l’époque, et ont tous eu une place « bordage » (un poste administratif important).
Ma mère retrouva rapidement sa vie modeste de fille de paysanne. Par contre, pour la petite histoire peu de temps après, les événements du cyclone de 1948, ont précipité le départ définitif des sœurs sur Saint-Leu. Les habitants de la ville ont dû les évacuer, encordées et par « canot ». “Bien fait pour elles” pensait tout haut, ma mère en me racontant cet épisode. Toutefois, l’école Sainte-Thérèse resta ouverte, mais pas forcément tenue par les sœurs.
J’aurais aimé raconter beaucoup d’anecdotes sur ma mère. Mais, sa longue période de maladie qui durait depuis ma naissance, et jusqu’à sa mort l’a contrainte à continuer d’avoir une vie, durant laquelle elle s’exprimait peu, entre médicaments et piqûres.
Cependant, elle avait des fois de magnifiques moments de lucidité où elle me racontait des tas d’histoires : des secrets de famille, ses souvenirs d’enfance et d’adolescence.
Du temps où elle avait toutes ses facultés mentales, c’était elle qui faisait toutes les lettres de demande en mariage de ses frères, avec les vieilles tournures françaises qui n’existent plus dans les correspondances actuelles. C’était clair qu’elle avait raté sa vocation, car ma mère dans ces instants là aurait fait une bonne institutrice, elle était très pédagogue, surtout avec ses petits-enfants pour lesquels elle faisait la « petite école » pendant les vacances.
Je n’ai hélas pas eu cette chance. Je me souviens que pour sa génération, elle était très ouverte sur le monde, elle me racontait tout ce qui se passait aux actualités télévisuelles dans le monde et en France métropolitaine, le lendemain matin.
Un des souvenirs les plus marquants des moments partagés avec ma mère, fut la période où nous avons dû réintégrer notre petite case, en terre bois sous tôle, et sans électricité de Grand Fond, croulant sous une végétation envahissante, suite à la fermeture de l’usine en 1978. Ma mère n’avait aucune expérience de la gestion d’un ménage car avant c’était grand-mère qui faisait tout. Cette année là, je faisais mon entrée en sixième au collège donc ma mère, la plupart du temps se retrouvait seule à la case.
Le week-end et les fins d’après-midi je l’aidais à affronter ses nouvelles responsabilités et du haut de mes douze ans, je devenais le nouveau chef de famille, car papa était presque toujours au travail.
Avec ma mère j’allais faire les courses à la boutik « Tikève » le samedi après-midi. Et si nous n’avions pas assez d’argent, on remettait le surplus des créances sur les fameux « carnets de crédits » qui s’additionnaient les semaines suivantes. N’ayant pas de frigidaire, durant les premiers jours des courses, nous mangions les produits frais, viande de porc, boudin, graton, le samedi soir. Une fois par mois, ma sœur cadette revenait de son travail de Saint-Denis, aussi nous nous tenons prêts à fêter le retour de la fille prodigue.
Le dimanche nous continuons le banquet avec le cari poulet et le rougail saucisse accompagné de limonade et vin « z’étoile » pour mon père, et un ultime rougail de boucané « péi » avec « zantac » le lundi. Après, les autres quatre jours de la semaine, sardine « Robert » et autres « Mackrel » au menu. Quelques fois simplement du maïs à toutes les sauces, issu des cultures de subsistance de la « bitasyon » familiale.
Peu nous importait cette pénible fin de semaine, ma mère et moi nous adorions ce week-end prolongé où nous pourrions nous adonner à toutes nos envies gastronomiques.
Le temps passait et notre petite case émergeait peu à peu du « carreau de l’encens » qui bordait son emplacement que mon père avait défriché, afin d’y installer des cultures de subsistances, pour un minimum d’autonomie financière.
Au fil du temps, notre confort s’améliorait. On avait l’eau courante. La terre battue des deux uniques pièces laissaient place au béton encaustiqué et les cloisons tapissées de journaux, à la mode de l’époque. Les deux pièces manquaient de lumière, de chambres à coucher et partiellement de ce qu’on appelait pompeusement un salon.
Des tableaux représentant des scènes religieuses étaient suspendus à des clous fixés dans des poteaux de bois de forêt un peu tordus. Derrière, l’un des tableaux était glissé un petit rameau béni.
Le mobilier du minuscule salon était très modeste, fait de meubles en contreplaqués et en « bacapan » alors qu’à l’époque où grand-mère vivait avec nous, nous possédions une grande armoire en bois « péi », sculptée de fleurs de lys, ainsi qu’une commode en « natte » posé dessus un vase, et un broc en porcelaine de grande qualité.
Le soir, on allumait une petite lampe à pétrole, de fabrication locale, dont la mèche était constituée par un morceau d’étoffe. Cette lampe éclairait mal, fumait et empestait le pétrole. Je me souviens que tous les matins avant d’aller à l’école, je mettais un bon quart d’heure afin de nettoyer mes narines noires de suie.
Notre cuisine, c’était un boucan, où les grandes personnes devaient se baisser pour passer la porte. On s’asseyait sur un morceau de bois, poli par l’usage, ou sur des petits bancs fabriqués par Monsieur Gilles qui nous avait aussi fabriqué, de manière artisanal, notre poulailler. Il était préférable de rester assis, à cause de la fumée qui stagnait à mi-hauteur, sinon on était obligé de sortir fréquemment pour s’essuyer les yeux, et reprendre son souffle.
En dépit de cette installation sommaire, c’était dans ce boucan que grand-mère cuisinait à mon avis les meilleurs caris, et autres gâteaux « lanmsim » ce qui était de loin le cas de maman.
Maxime Laope, le plus grand ségatier de l’île aux yeux de ma mère chantait que « la misère lé pa in vis mais in boulon », heureusement qu’en début de ses années 80 cette misère noire finit par nous lâcher, et de manière fulgurante tout s’enchaîna.
En 1981 nous recevons enfin l’électricité pour moi c’était un des plus beaux jours de ma vie, fini les narines noires de suie. Nous étions tellement contents ma mère et moi que nous avons laissé la lumière allumée toutes les nuits jusqu’au petit matin, pendant une semaine de peur qu’elle s’éteigne subitement.
En 1983, la DDASS agrandit notre maison d’une pièce supplémentaire avec le luxe suprême d’avoir à l’intérieur de la maison la douche et les toilettes.
L’année ensuite, nous nous achetons notre première télévision en couleur. Et en 1986, suite à un « rappel » touché par ma mère pour sa pension d’invalidité, nous agrandissons notre maison en ajoutant trois pièces supplémentaires : ma chambre personnelle, un vrai grand salon avec des meubles modernes et neufs, et une cuisine salle à manger, équipée. Rasé le boucan qui faisait office de cuisine. Le revenu régulier de ma mère sous forme de pension d’invalidité en plus du « beckage de clé » de mon père, nous assura depuis ce jour une vie moins misérable.
Malgré son état souvent léthargique, je garde le souvenir d’une mère qui avait de l’ambition pour son fils. Elle a tout fait pour que j’aille à l’école le plus loin possible. Ce qui déjà était un exploit dans les familles modestes, où il fallait penser ce qu’il fallait mettre dans la marmite d’abord. Il est arrivé plusieurs fois où ma mère avait clairement fait le choix d’investir dans les manuels scolaires alors que nous n’avions pas grand-chose à manger. Notamment, je pense à l’achat de mon premier dictionnaire de français lors de mon entrée en sixième en 1978.
Ma mère avait toujours voulu pour moi une petite place « bordage » à la mairie de sa ville. Mais en fils indigne que j’étais, j’avais choisi (heureusement) une autre voie où j’allais être plus libre.
Maman est partie sereinement dans son lit le 31 juillet 2003, lasse des piqûres et des médicaments, à la veille d’un évènement unique sur l’île : la neige sur les hauts sommets de la Réunion qui allait durer plusieurs jours.
Joli pied de nez à un karma difficile qu’elle a eu tout au long de sa vie, ce jour là, elle n’a pas attendu son rituel café au lit, apporté par papa, tous les matins depuis sa retraite ».
Clovis Etchiandas