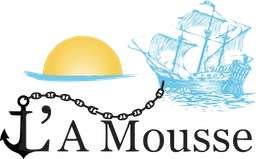Clovis Etchiandas : « Mon père, ce héros ! » (3) HISTOIRE DE LA REUNION

Nous vous proposons la troisième et dernière partie du récit sur son père de Clovis Etchiandas. Le célèbre guide touriste réunionnais parle dans cet épisode, de la fierté et de l’amour non-dits ou non dévoilés, mais vécus intensément dans une discrétion. Le Saint-Leusien évoque aussi et longuement la mort de son papa. Une fin. Et un commencement. Des rires. Des larmes. Des rires. La vie continue…
Comme les hommes de sa trempe, mon père caractérisait bien sa génération. Au-delà de leur mission principale, faire vivre leur famille en amenant l’argent à la case, il était rarement question d’exprimer un quelconque sentiment arrivés au domicile familial où ils empruntaient la carapace du personnage sévère, insensible et muet comme une carpe.
Par contre, mon père se déridait souvent après avoir bu un petit coup de trop, il avait plutôt le rhum gai car jamais quand il était dans cet état là il avait levé la main sur ma mère ou sur nous. Ce qui était à cette époque monnaie courante dans beaucoup de foyers.
Dans ma vision de marmaille, du fait que mon père n’exprimait quasiment jamais son amour me concernant, j’avais fini par croire que ma vie ne l’intéressait guère, aussi j’ai fini par faire mon bonhomme de chemin en ignorant sa présence.
Mais un beau jour de 1986 je n’étais au bout de ma surprise. J’étais revenu du lycée Amiral Bouvet de Saint-Benoît où j’étais interne pendant la semaine avec mon BAC en poche. J’avais donné la primeur de la bonne nouvelle à ma mère, comme à l’accoutumé mon père qui était présent n’a pas sourcillé, puis il est sorti faire son tour, car il restait rarement très longtemps à la maison.
Après cette grande émotion retombée, je fini à mon tour de sortir « bat in carré » afin de faire profiter de la nouvelle aux autres membres de la famille et amis. Telle ne fut donc ma surprise d’entendre un bon nombre de « gramounes » des quartiers Stella et Grand Fond me féliciter. Mon père avait déjà répandu la nouvelle. A cet instant-là, j’ai su que mon père était fier de moi. C’était un peu dommage d’attendre d’avoir vingt ans pour le savoir.
Des légendes ou réalité, j’en ai entendu sur mon père. Notamment, on disait de lui qu’il a vendu sa terre à un commerçant chinois renommé du quartier de Grand Fond pour « des crédits de rhum à vie » son talon d’Achille, en plus d’une robe de couleur rouge pour ma mère (maman détestait cette couleur) et un bœuf. Le malin commerçant a exploité l’état d’ignorance, et de vulnérabilité psychique dans lequel était mon père : la la dépendance à l’alcool et surtout la pauvreté était à l’époque, comme chantait Maxime Laope, n’était pas « un vis mais un boulon ».
Papa pouvait user toutes les stratégies possibles pour pouvoir boire son « pti coup sec ». Une anecdote me revient en souvenir : certains dimanches, papa allait voir maman à l’hôpital et demandait à tante Mariette (sa sœur chez qui nous vivions à l’époque) de la monnaie afin de prendre le bus de ligne, et d’acheter ses sacro-saint cigarettes, les bastos bleus.
Au final, il partait à pied quelques fois jusqu’à Saint-Paul et se rinçait le gosier tout le long du parcours à chaque « boutik sinwa » et autres qu’il trouvait. Et je peux vous dire qu’à l’époque il en avait « en poundiak » (il y avait l’embarras du choix), entre les boutiques Mamie, Loulou à Stella, Moy, Boudia, Lingou, Karner, Van Hoy, Fung Chat, etc..
« L’armé » comme on le surnommait affectueusement dans son quartier, s’est éteint le samedi 5 avril 2008 à 9H15 à l’hôpital de Cilaos suite à un cancer de l’intestin qui durait depuis 5 ans (date à laquelle maman est décédée). Cette pathologie s’était aggravée en se généralisant. Néanmoins, en allant récupérer son corps à Cilaos, j’ai découvert le visage d’un homme paisible. Serein. Comme s’il était soulagé de souffrir et partir enfin rejoindre sa femme dont il s’est jamais vraiment séparé, ne serait-ce par la pensée.
Je n’ai pu m’empêché de faire un parallèle avec ses grands « Marons » malgaches qui s’enfuyaient dans les montagnes afin d’acquérir leur liberté, même en bravant la mort. Ses noms malgaches résonnent encore dans ses lieux comme Tsilaosa, le lieu que l’on ne quitte pas. Ce n’est pas un hasard si Papa est allé rejoindre ses ancêtres à Cilaos. De son vivant, il adorait, avec maman, venir me rendre visite là-bas « pays » où j’ai passé plus de six ans de ma vie arpentant tous les moindres sentiers du Cirque.
Je voudrais ici rendre hommage à cet homme libre qui a toujours croqué la vie à pleines dents. Cet infatigable « travailleur tabisman » particulièrement courageux, infiniment honnête et droit, surtout en amitié. Car je ne lui connaissais pas d’ennemi. Un brin malicieux quand il voulait enrager ma mère afin qu’elle lui laisse en paix, boire sa « mandoze ». Son expression préféré était : « quelqu’un qui boit se fait toujours des amis » en créole dans le texte (car mon père n’était pas vraiment un fervent de la langue de Molière) « in moun i boi na toujours camarade ».
Mon père était un « Malgache » et dans la tradition séculaire malgache, la mort n’est pas vraiment la fin, on va pleurer à la naissance d’un bébé, car on ne sait pas ce qui l’attend dans sa vie terrestre, mais on va joyeusement accompagner un mort, car celui-ci sera libéré de ses malheurs terrestres.
D’ailleurs à la veillée de mon père (juin 2008), ses parents et amis étaient pratiquement tous là. C’est là qu’on voit que votre père était quelqu’un de très apprécié. Plus que de pleurs je n’ai entendu que des anecdotes marrantes racontées par ses « dalons » qui étaient venus lui rendre un dernier hommage. Lui qui se rendait souvent dans les veillés mortuaires, il était connu pour être « un casseur lé cui ». Les grenouilles de bénitier il ne supportait pas ça. La tradition créole des veillées de jadis fut donc respectée.
Etait présent surtout son « dalon » de toujours Monsieur Sateya Eugène (lui-même dcd depuis), qui m’a raconté énormément de faits de leur vie d’ouvrier d’usine de canne à sucre. Car à eux deux, ils formaient un vrai binôme avec une confiance mutuelle. Car, la plupart du temps, ils travaillaient en équipe. Papa qui était l’aîné, était devenu son « dalon ». Il admirait mon père car celui-ci était endurant, il était chargé d’alimenter les chaudières qui dégageait une chaleur intense. Pendant plus de huit heures, il était lié à cette tâche titanesque. Comme il plaisantait souvent là-dessus, il disait « mwin lé in kaf na sept peaux dur comme bœuf Moka ».
Leur travail consistait à se munir de râteaux, récupérer les fibres de bagasses (résidus ligneux des cannes broyés), employés comme combustible, qu’ils enfournaient sans relâche dans des trappes ouvertes au-dessus des foyers, afin d’alimenter le feu terrible qui y brûlait continuellement. Il me racontait une autre anecdote qui en disait long sur leur immuable solidarité et leur droiture.
A l’époque où Monsieur Etienne Dussac était directeur dans les années 1950, la structure de l’usine était différente de celle des années 70, à sa fermeture. L’implantation de plusieurs moteurs ou cylindres, dont le fonctionnement représentait un danger, était souvent mal disposé.
C’était le cas à l’usine Stella, les ouvriers dont mon père et Monsieur Sateya faisaient parti, l’ont signalé à la direction, mais rien n’a bougé, et ce qui devait arriver arriva. Pendant le quart de nuit, un des ouvriers s’était fracturé les cervicales « kass colé » sur l’un des cylindres. En tant que témoins de la scène, nos deux compagnons furent convoqués par la direction. Monsieur Dussac lui-même a voulu les acheter, en les faisant changer de version n’incriminant pas sa responsabilité. Mais nos deux « dalons » sont restés droits dans leurs bottes, Et ce malgré la précarité et la pauvreté dans laquelle ils étaient. Ils ont voulu que cet argent revienne à la veuve de l’ouvrier décédé. Et, ils ont obtenus gain de cause.
Cela m’a fait chaud au cœur d’entendre cette histoire sur mon père, pour qui j’avais jusqu’à présent une opinion mitigée. Car je le voyais toujours à travers les yeux de la gente féminine qui l’entourait, notamment grand-mère dont le jugement était peu flatteur. Et à Monsieur Sateya de rajouter « ton père n’a jamais eu un seul blâme dans toute sa carrière d’ouvrier ». A titre posthume, hélas, cette nuit-là j’étais enfin fier de mon père.
Je remercie Monsieur Sateya de redorer le blason d’un homme qui avait la réputation d’être toujours joyeux, aimant (selon les dires de ses nièces) et qui a toujours été honnête avec les autres. Son seul défaut, il était perturbé de ce que les gens pensaient de lui, surtout de sa capacité d’être autonome à mener son ménage, dans une droiture. Hélas, il n’a pas su maîtriser son destin à cause de son penchant pour « la mandoze ».
En tant que seul fils, le soir de veillée c’est moi qui ai donné le ton, en racontant tout ce que je savais de marrant, concernant mon père, les larmes viendraient plus tard.
Textes : Clovis Etchiandas, guide touristie